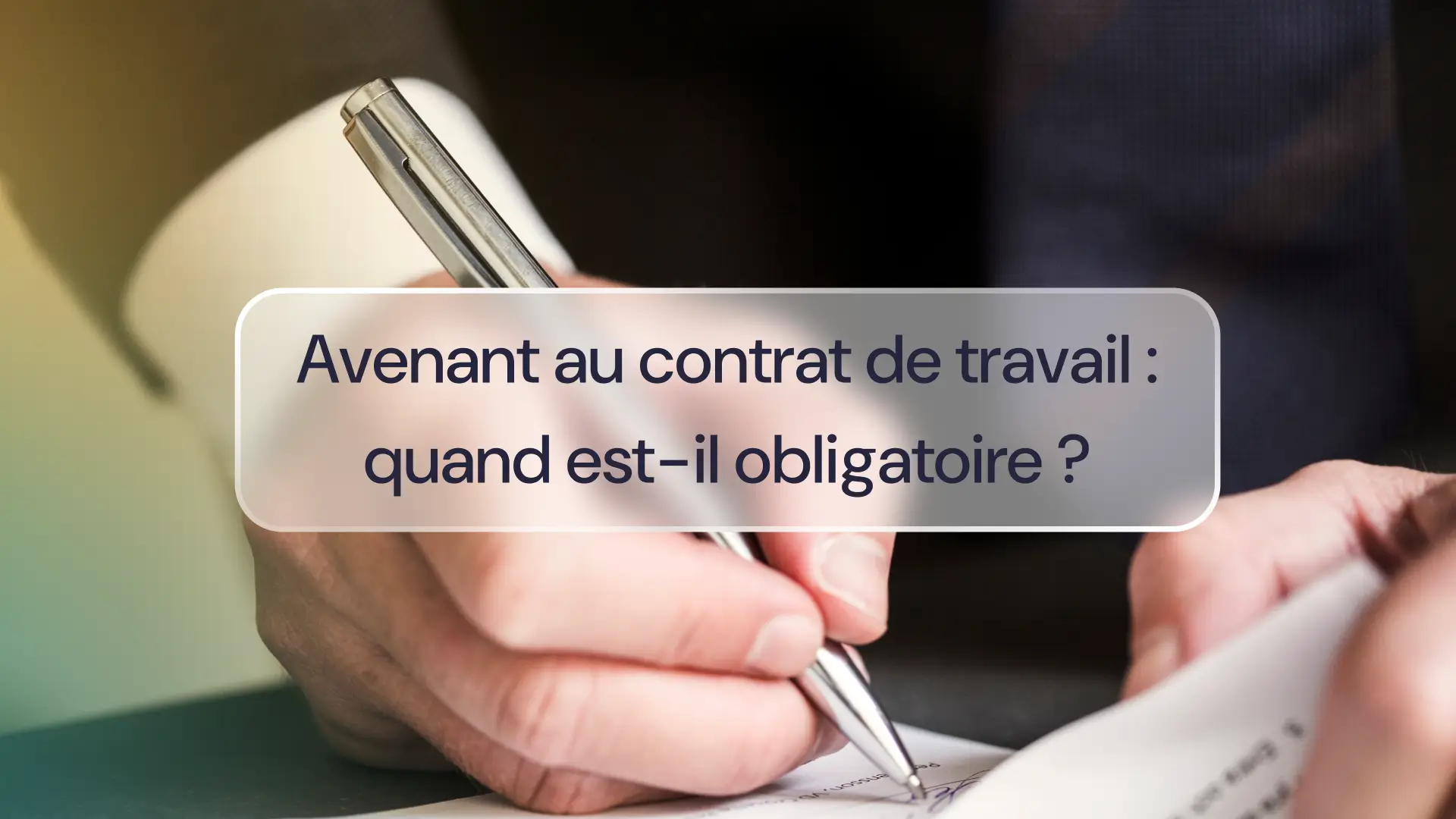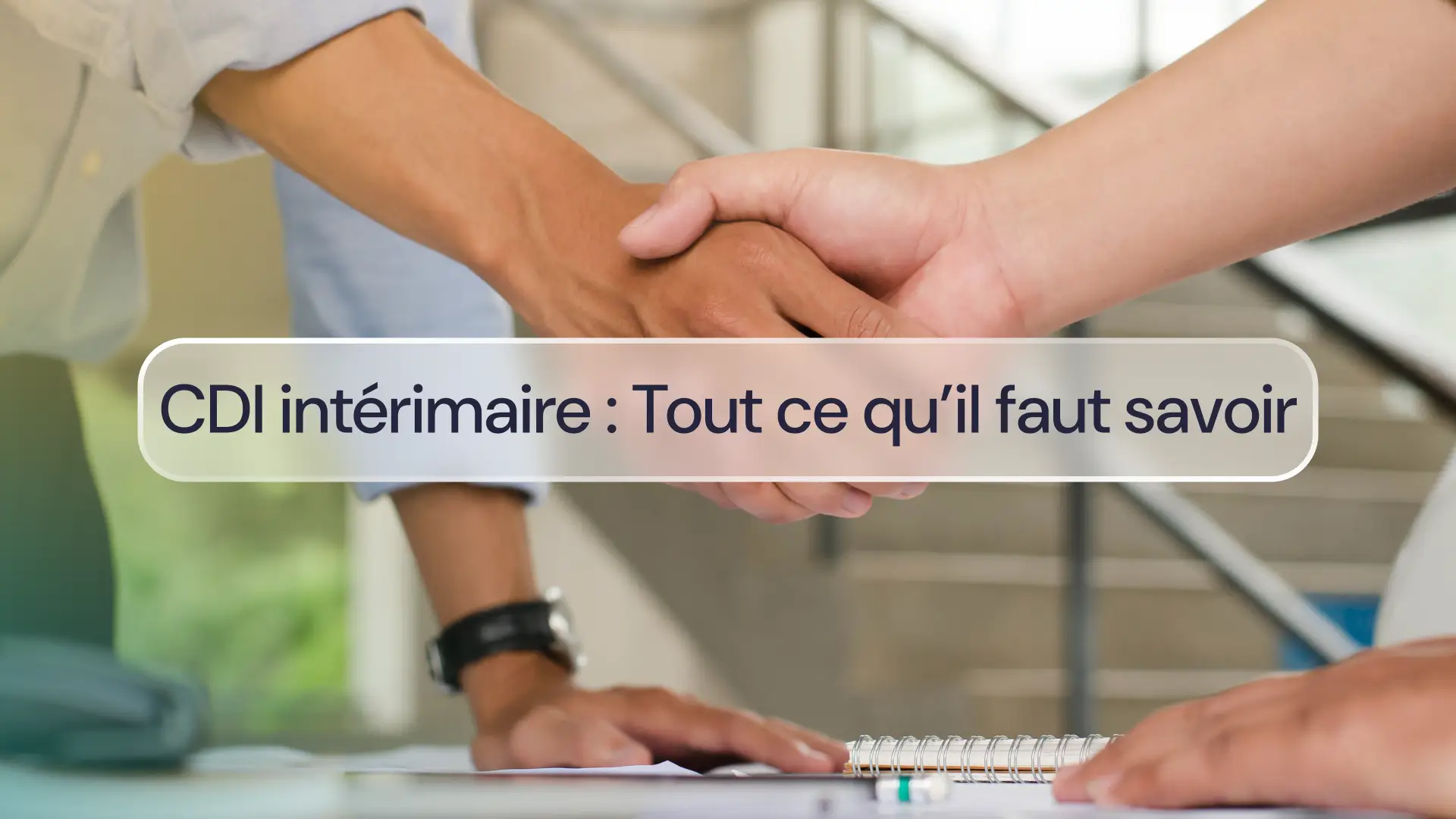Le paysage des ressources humaines vient de connaître un tournant majeur. Depuis le 26 octobre 2025, l’entretien de parcours professionnel remplace officiellement l’entretien professionnel tel qu’on le connaissait. Cette transformation, portée par la loi du 24 octobre 2025, bouleverse les pratiques RH établies depuis des années : fini les rendez-vous biennaux systématiques, place à un dispositif repensé qui s’étire sur quatre ans et s’enrichit de nouveaux contenus obligatoires.
Pour les responsables RH et les managers, cette réforme de l’entretien professionnel impose une réorganisation complète. La périodicité change, les thématiques s’élargissent, et de nouveaux entretiens spécifiques font leur apparition pour les salariés en milieu et fin de carrière. Mais au-delà des obligations légales, c’est toute la philosophie de l’accompagnement des parcours qui évolue : l’entretien devient un véritable outil de gestion prévisionnelle, ancré dans une vision à long terme du développement professionnel.
Décryptage complet des nouvelles règles, des échéances à respecter et des bonnes pratiques pour mettre en œuvre ce dispositif rénové dans votre entreprise.
L’entretien de parcours professionnel : définition et nouvelle philosophie
Qu’est-ce que l’entretien de parcours professionnel ?
L’entretien de parcours professionnel n’est pas qu’un simple changement de nom. Cette nouvelle dénomination, inscrite dans l‘article L. 6315-1 modifié du Code du travail, marque une vraie rupture dans la manière d’accompagner les salariés. Là où l’ancien dispositif se concentrait principalement sur les perspectives d’évolution à court terme, le nouveau cadre légal impose une approche globale et continue de la trajectoire professionnelle.
Concrètement, cet entretien devient un rendez-vous stratégique entre le salarié et son employeur pour construire ensemble l’avenir professionnel au sein de l’entreprise. Il ne s’agit plus seulement de cocher des cases administratives tous les deux ans, mais d’installer un dialogue structuré qui anticipe les transformations de l’organisation, identifie les besoins en compétences et prépare les transitions de carrière.
D’où vient l’entretien de parcours professionnel ?
Cette évolution s’inscrit dans la transposition de trois accords nationaux interprofessionnels signés en 2024 et 2025, qui placent l’emploi des seniors et l’accompagnement des parcours au cœur des préoccupations sociales. L’objectif affiché : transformer un outil parfois perçu comme une formalité en un véritable levier de gestion des talents et de prévention de l’usure professionnelle.
Comme pour l’ancien entretien professionnel, l’entretien de parcours professionnel ne doit absolument pas porter sur l’évaluation du travail du salarié. Cette distinction, expressément précisée dans la loi, le différencie clairement de l’entretien annuel d’évaluation, qui reste un exercice distinct et complémentaire.
Ce que change concrètement la réforme d’octobre 2025
Réforme de l’entretien professionnel : les 5 changements majeurs

La loi du 24 octobre 2025 redessine profondément le cadre des entretiens professionnels. Voici les transformations qui impactent directement votre gestion RH.
Une nouvelle périodicité qui bouleverse le calendrier
Le changement le plus visible concerne la périodicité de l’entretien de parcours professionnel. Exit le rendez-vous biennal qui rythmait la vie des entreprises depuis 2014. Le nouveau dispositif instaure un calendrier plus espacé mais mieux ciblé.
Premier entretien : il doit désormais avoir lieu au cours de la première année suivant l’embauche, et non plus systématiquement tous les deux ans dès l’arrivée du salarié. Ce timing permet d’accompagner l’intégration et d’identifier rapidement les besoins de formation du nouveau collaborateur.
Périodicité régulière : les entretiens suivants s’organisent ensuite tous les 4 ans, sauf disposition plus favorable prévue par un accord collectif d’entreprise ou de branche. Attention toutefois, même avec un accord, cette périodicité ne peut jamais dépasser quatre ans. Ce rythme quadriennal vise à aligner l’entretien sur des cycles de transformation plus réalistes dans l’entreprise.
Cette nouvelle temporalité change la donne pour les services RH qui devaient jusqu’ici jongler avec des centaines d’entretiens annuels. La gestion des performances nécessite désormais une planification différente, étalée dans le temps mais plus substantielle dans son contenu.
L’état des lieux récapitulatif passe de 6 à 8 ans
Autre modification d’importance : l’état des lieux récapitulatif du parcours professionnel, qui permettait jusqu’ici de faire le point tous les six ans sur les formations suivies et les progressions du salarié, s’espace lui aussi. Il intervient désormais tous les 8 ans.
Ce bilan global reste un moment privilégié pour mesurer l’évolution professionnelle et salariale, vérifier que le salarié a bien bénéficié des entretiens obligatoires et qu’il a suivi au moins une action de formation non obligatoire ou acquis des éléments de certification.
Des entretiens renforcés aux moments clés de la carrière
La réforme introduit deux entretiens de parcours professionnel renforcés qui marquent une attention particulière portée à la seconde partie de carrière. Ces rendez-vous spécifiques visent à prévenir l’usure professionnelle et à anticiper les fins de parcours.
L’entretien de mi-carrière (autour de 45 ans) doit être organisé dans les deux mois suivant la visite médicale de mi-carrière réalisée par le médecin du travail. Au-delà des thématiques habituelles, cet entretien aborde spécifiquement l’adaptation ou l’aménagement des missions et du poste, la prévention des situations d’usure professionnelle, ainsi que les éventuels souhaits de mobilité ou de reconversion professionnelle. Un document écrit récapitule l’ensemble des éléments discutés.
L’entretien de fin de carrière intervient quant à lui dans les deux années précédant le 60ème anniversaire du salarié. Il se penche sur les conditions de maintien dans l’emploi et explore les possibilités d’aménagements : passage à temps partiel avec éventuelle compensation de rémunération, retraite progressive, ou encore conditions d’accompagnement vers le départ à la retraite.
Ces deux entretiens répondent à un constat alarmant : selon les données de la Défenseure des droits publiées en décembre 2024, un quart des seniors déclarent avoir vécu des discriminations dans l’emploi, et seul un tiers des demandeurs d’emploi de 50 ans et plus retrouvent un poste.
Un calendrier d’application à maîtriser
La loi est entrée en vigueur le 26 octobre 2025, lendemain de sa publication au Journal Officiel. Cependant, le législateur a prévu un délai de transition pour permettre aux entreprises de s’adapter.
Les entreprises disposant déjà d’un accord collectif sur les entretiens professionnels doivent engager une négociation avant le 1er octobre 2026 pour réviser leurs accords et les mettre en conformité avec le nouveau cadre. À partir de cette date, les nouvelles dispositions s’appliquent obligatoirement à toutes les entreprises, avec ou sans accord préalable.
Assouplissement du retour après absence
Dernière modification notable : l’entretien n’est plus systématiquement proposé au retour de congés ou d’arrêts longue durée (congé maternité, adoption, parental d’éducation, proche aidant, longue maladie, sabbatique, etc.). Il ne sera désormais proposé que si le salarié n’a pas bénéficié d’un entretien au cours des 12 mois précédant sa reprise d’activité. Cette disposition évite les doublons et allège la charge administrative des retours échelonnés.
Pour mieux comprendre l’articulation entre ces différents entretiens, consultez notre guide des règles de l’entretien professionnel.
Les obligations de l'employeur : ce que dit la loi
Quelles sont les obligations de l’employeur en matière d’entretien de parcours professionnel ?
L’organisation de l’entretien de parcours professionnel repose entièrement sur l’employeur. Cette responsabilité ne se délègue pas et engage la conformité légale de l’entreprise. Décryptage des règles à respecter impérativement.
Qui organise et qui mène l’entretien ?
C’est à l’employeur de prendre l’initiative. L’entretien doit être organisé par l’employeur et conduit soit par un supérieur hiérarchique direct, soit par un représentant de la direction de l’entreprise. Impossible donc de laisser le salarié en demande : la loi impose une démarche proactive de la part de l’organisation.
Cette responsabilité s’étend bien au-delà de la simple planification d’un rendez-vous. Elle suppose d’avoir structuré en amont un dispositif complet : identification des salariés concernés selon leur ancienneté et leur date d’embauche, formation des managers aux nouvelles thématiques obligatoires, préparation des documents support. Un logiciel RH devient vite indispensable pour piloter ces échéances sans oublis ni retards.
Un temps de travail à part entière
Point non négociable : l’entretien de parcours professionnel se déroule obligatoirement pendant le temps de travail. Il ne peut être organisé en dehors des horaires contractuels du salarié, sauf accord explicite de ce dernier. Cette règle garantit que l’accompagnement du parcours professionnel s’inscrit pleinement dans la relation de travail et ne relève pas du temps personnel.
Pour les salariés à temps partiel ou en horaires atypiques, cette obligation impose une vigilance particulière dans la planification. L’entretien doit s’inscrire dans les plages habituelles de présence, et le temps consacré à cet échange est bien entendu rémunéré comme du temps de travail effectif.
La production d’un document écrit obligatoire
À l’issue de chaque entretien de parcours professionnel, l’employeur doit rédiger un document de synthèse. Une copie est remise au salarié : cette formalité n’est pas facultative. Le document trace les thématiques abordées, les souhaits exprimés par le salarié, les besoins de formation identifiés et les perspectives d’évolution discutées.
Ce support écrit revêt une importance juridique considérable. En cas de contentieux sur le respect des obligations de formation ou de gestion de carrière, il constitue une pièce probatoire. À l’inverse, l’absence de document peut être invoquée par le salarié pour démontrer que l’entretien n’a pas eu lieu ou n’a pas été mené dans les règles. Notre article sur le compte rendu d’entretien professionnel détaille les mentions indispensables à faire figurer dans ce document.
Cas particuliers : le retour après absence prolongée
La loi prévoit un dispositif spécifique pour les salariés qui reprennent leur activité après une absence longue durée. Qu’il s’agisse d’un congé parental d’éducation, d’un congé de proche aidant, d’un congé sabbatique, d’un arrêt longue maladie ou d’un congé maternité ou adoption, l’employeur doit se poser une question simple : le salarié a-t-il bénéficié d’un entretien au cours des 12 mois précédant sa reprise d’activité ?
Si la réponse est non, l’entretien doit être proposé. Si un entretien a déjà eu lieu dans cette période, rien n’oblige l’employeur à en organiser un nouveau immédiatement. Cette souplesse évite de multiplier les rendez-vous pour des salariés qui enchaînent plusieurs absences courtes ou qui reprennent progressivement.
Sanctions en cas de non-respect
Le non-respect des obligations relatives aux entretiens professionnels expose l’entreprise à des conséquences financières. Lorsqu’un salarié n’a pas bénéficié des entretiens prévus au cours d’une période de référence (notamment lors de l’état des lieux récapitulatif de 8 ans), l’employeur doit procéder à un abondement correctif du compte personnel de formation du salarié concerné. Ce montant, fixé à 3 000 euros pour un salarié à temps complet (proratisé pour un temps partiel), vient directement alimenter les droits à la formation du collaborateur lésé.
Au-delà de la sanction financière, cette défaillance peut aussi constituer un manquement aux obligations de l’employeur en matière d’adaptation au poste et de maintien dans l’emploi, potentiellement invocable dans le cadre d’un contentieux prud’homal.
Obligations renforcées de négociation collective
La loi du 24 octobre 2025 renforce également le cadre du dialogue social sur ces questions. Les entreprises d’au moins 300 salariés doivent désormais négocier tous les 3 ou 4 ans sur l’emploi et le travail des salariés expérimentés. Cette négociation devient autonome, distincte de la gestion prévisionnelle des emplois et compétences (GPEC).
Les branches professionnelles portent elles aussi une responsabilité accrue : elles doivent engager cette même négociation tous les 3 ans (modifiable à 4 ans par accord). L’objectif est de structurer des dispositifs sectoriels adaptés aux réalités de chaque profession et d’harmoniser les pratiques au-delà des seules initiatives d’entreprise.
Enfin, les entreprises doivent intégrer dans leur base de données économiques, sociales et environnementales (BDESE) un bilan de la mise en œuvre des actions de formation entreprises à l’issue des entretiens de parcours professionnels. Cette transparence permet aux représentants du personnel de suivre l’effectivité du dispositif et d’identifier d’éventuels dysfonctionnements.
Déroulement et contenu : les 5 thématiques obligatoires
Comment se déroule l’entretien de parcours professionnel ?
L’entretien de parcours professionnel se distingue radicalement de l’entretien annuel d’évaluation. Cette distinction mérite d’être martelée tant elle est structurante : l’entretien de parcours professionnel ne porte en aucun cas sur l’évaluation du travail du salarié.
Pas de notation, pas de jugement sur les performances passées, pas de bilan des objectifs atteints ou manqués. L’entretien annuel d’évaluation, qui reste un outil distinct et complémentaire, conserve cette fonction d’appréciation. Pour bien saisir cette différence fondamentale, notre article sur la différence entre entretien d’évaluation et entretien professionnel apporte un éclairage précieux.
Ici, l’enjeu est ailleurs : construire un échange entre salarié et employeur tourné vers l’avenir, les compétences à développer, les trajectoires possibles. C’est un moment de projection, pas de bilan comptable. Cette philosophie irrigue les cinq domaines que la loi impose désormais d’aborder systématiquement.
Les compétences et qualifications : état des lieux et évolution
Premier axe obligatoire : faire le point sur les compétences du salarié et les qualifications mobilisées dans son emploi actuel. Il s’agit d’identifier ce que le collaborateur maîtrise réellement, au-delà de ce que prévoit sa fiche de poste théorique. Quelles compétences techniques met-il en œuvre au quotidien ? Quels savoir-faire relationnels ou organisationnels déploie-t-il ? Cette cartographie doit être menée avec précision, car elle sert de socle à toute la suite de l’entretien.
Mais l’exercice ne s’arrête pas à ce constat. La loi impose d’aborder l’évolution possible de ces compétences au regard des transformations de l’entreprise. Cette dimension prospective change tout. Elle suppose que l’employeur ait réfléchi en amont aux mutations technologiques, organisationnelles ou stratégiques qui affectent ou vont affecter l’activité. Transition numérique, automatisation de certaines tâches, évolution des process, réorganisation des équipes : tous ces mouvements doivent être mis en perspective avec les compétences actuelles du salarié pour anticiper les besoins d’adaptation.
Situation et parcours professionnels : perspectives dans l’entreprise
Deuxième thématique incontournable : la situation et le parcours professionnel du salarié, analysés au regard des évolutions des métiers et des perspectives d’emploi dans l’entreprise. Cette obligation pousse l’employeur à sortir d’une vision figée des postes et des carrières. Où en est le salarié dans son parcours ? Quel chemin a-t-il déjà parcouru depuis son embauche ? Quelle place occupe-t-il dans l’organigramme et dans les dynamiques collectives ?
L’entretien doit ensuite projeter cette trajectoire individuelle sur la cartographie des métiers de l’entreprise. Certains postes sont-ils amenés à disparaître ? D’autres émergent-ils ? Quelles passerelles existent entre les différentes fonctions ? Cette approche GPEC (gestion prévisionnelle des emplois et compétences) à l’échelle individuelle permet au salarié de comprendre comment son métier évolue et quelles opportunités s’ouvrent à lui. Elle sécurise aussi l’entreprise en anticipant les mobilités internes nécessaires.
Besoins de formation : actuels, futurs et personnels
Troisième domaine obligatoire, et probablement le plus attendu : les besoins de formation du salarié. La loi impose d’explorer trois dimensions complémentaires.
D’abord, les besoins liés à l’activité professionnelle actuelle. Quelles formations permettraient au salarié de mieux exercer ses missions présentes ? Maîtrise d’un nouveau logiciel, perfectionnement technique, développement de compétences managériales : l’idée est d’identifier ce qui renforcerait l’efficacité immédiate.
Ensuite, les besoins liés à l’évolution de l’emploi. Cette dimension rejoint la réflexion sur les transformations de l’entreprise évoquée précédemment. Si le poste va muter, quelles formations prépareront le salarié à ces changements ? Si une mobilité interne se profile, quels acquis doit-il développer pour y accéder ?
Enfin, et c’est une nouveauté importante, les besoins liés à un projet professionnel personnel. Le salarié peut avoir des aspirations qui dépassent le cadre strict de son poste actuel ou même de son entreprise. L’entretien doit accueillir ces projets sans jugement et explorer comment des actions de formation pourraient les soutenir, même s’ils conduisent à terme vers une sortie de l’organisation.
Souhaits d’évolution professionnelle : reconversions et mobilités
Quatrième axe structurant : les souhaits d’évolution professionnelle du salarié. Cette thématique ouvre un spectre très large de possibilités. La loi liste explicitement plusieurs dispositifs qui peuvent être mobilisés.
La reconversion interne permet d’envisager un changement radical de métier au sein même de l’entreprise. Un commercial qui souhaiterait basculer vers les ressources humaines, un technicien attiré par la formation, un logisticien tentant une évolution vers le marketing : ces trajectoires transversales doivent pouvoir être discutées sans tabou.
La reconversion externe ou le projet de transition professionnelle concernent les salariés qui envisagent un changement de métier impliquant potentiellement une sortie de l’entreprise. L’entretien doit permettre d’évoquer ces aspirations et d’orienter le collaborateur vers les dispositifs adaptés, notamment le CPF de transition professionnelle qui finance des formations longues diplômantes.
Le bilan de compétences constitue un autre levier à aborder. Ce dispositif, financé par le compte personnel de formation ou par l’employeur, permet au salarié de faire le point sur ses aptitudes, motivations et possibilités d’évolution professionnelle.
Enfin, la validation des acquis de l’expérience (VAE) offre la possibilité d’obtenir un diplôme ou une certification en faisant reconnaître son expérience professionnelle. L’entretien peut identifier les salariés qui pourraient bénéficier de ce dispositif et les accompagner dans leur démarche.
Compte personnel de formation et accompagnement : les leviers concrets
Cinquième et dernier domaine obligatoire : l’activation du compte personnel de formation (CPF), les abondements possibles et le conseil en évolution professionnelle. Cette dimension très opérationnelle transforme les échanges en actions concrètes.
L’entretien doit d’abord faire le point sur le solde CPF du salarié. Combien d’heures ou d’euros a-t-il capitalisés ? Ce capital formation est-il suffisant pour financer les actions identifiées lors de l’entretien ? Le salarié sait-il comment consulter son compte et mobiliser ses droits ?
Ensuite, l’employeur doit informer le salarié sur les abondements qu’il peut financer. Ces compléments versés par l’entreprise permettent de compléter les droits CPF du salarié pour des formations coûteuses ou stratégiques. Certains accords de branche ou d’entreprise prévoient des abondements automatiques dans certaines situations, notamment pour les salariés les moins qualifiés ou en reconversion.
Enfin, l’entretien doit mentionner l’existence du conseil en évolution professionnelle (CEP), un service gratuit et personnalisé proposé par différents opérateurs (France Travail, APEC, missions locales, etc.). Ce dispositif accompagne les actifs dans leurs projets d’évolution ou de reconversion, en dehors de toute pression hiérarchique. L’employeur doit informer le salarié de cette possibilité sans pour autant l’orienter vers un opérateur particulier.
Pour aller plus loin dans la préparation de ces échanges, consultez notre guide pratique sur l’entretien professionnel qui détaille les questions à poser et les documents à préparer. Une fois l’entretien terminé, il reste à définir les actions concrètes à mettre en œuvre, un sujet que nous approfondissons dans notre article sur les actions post-entretien individuel.
Ce qu’il faut retenir de ce nouveau dispositif
L’entretien de parcours professionnel marque une rupture dans la manière d’accompagner les trajectoires professionnelles. Avec sa nouvelle périodicité tous les quatre ans, ses cinq thématiques obligatoires et ses entretiens renforcés pour les seniors, ce dispositif transforme une obligation administrative en véritable outil stratégique de gestion des talents.
Les entreprises ont jusqu’au 1er octobre 2026 pour adapter leurs pratiques et leurs accords collectifs. Cette année de transition ne doit pas être sous-estimée : mise à jour des processus RH, formation des managers aux nouveaux contenus, refonte de la documentation, planification des premiers entretiens selon le nouveau calendrier. L’ampleur du chantier justifie d’agir dès maintenant plutôt que d’attendre la dernière échéance.
Au-delà de la conformité légale, cette réforme invite à repenser l’accompagnement des parcours dans une logique plus prospective.
En imposant d’aborder les transformations de l’entreprise, les évolutions des métiers et les projets personnels des salariés, la loi pousse les organisations à installer un dialogue continu sur les compétences et l’employabilité. Cette approche bénéficie autant aux collaborateurs, qui gagnent en visibilité sur leur avenir, qu’aux employeurs qui anticipent mieux leurs besoins en compétences et limitent les risques d’obsolescence professionnelle.
Pour les services RH déjà sollicités sur de multiples fronts, la gestion de ces entretiens peut rapidement devenir un casse-tête logistique.
Centraliser les informations, suivre automatiquement les périodicités, générer des rappels avant les échéances, conserver l’historique des documents : autant de tâches qui gagnent à être automatisées. Des solutions RH comme Factorial permettent précisément de piloter l’ensemble du cycle de vie des entretiens de parcours professionnels, de la planification à l’archivage des comptes rendus, en passant par les relances automatiques et le suivi des plans d’action. Cette automatisation libère du temps pour se concentrer sur l’essentiel : la qualité de l’accompagnement et la construction de parcours durables.
N’hésitez pas à demander une démo pour voir comment le logiciel accompagne cette évolution réglementaire.