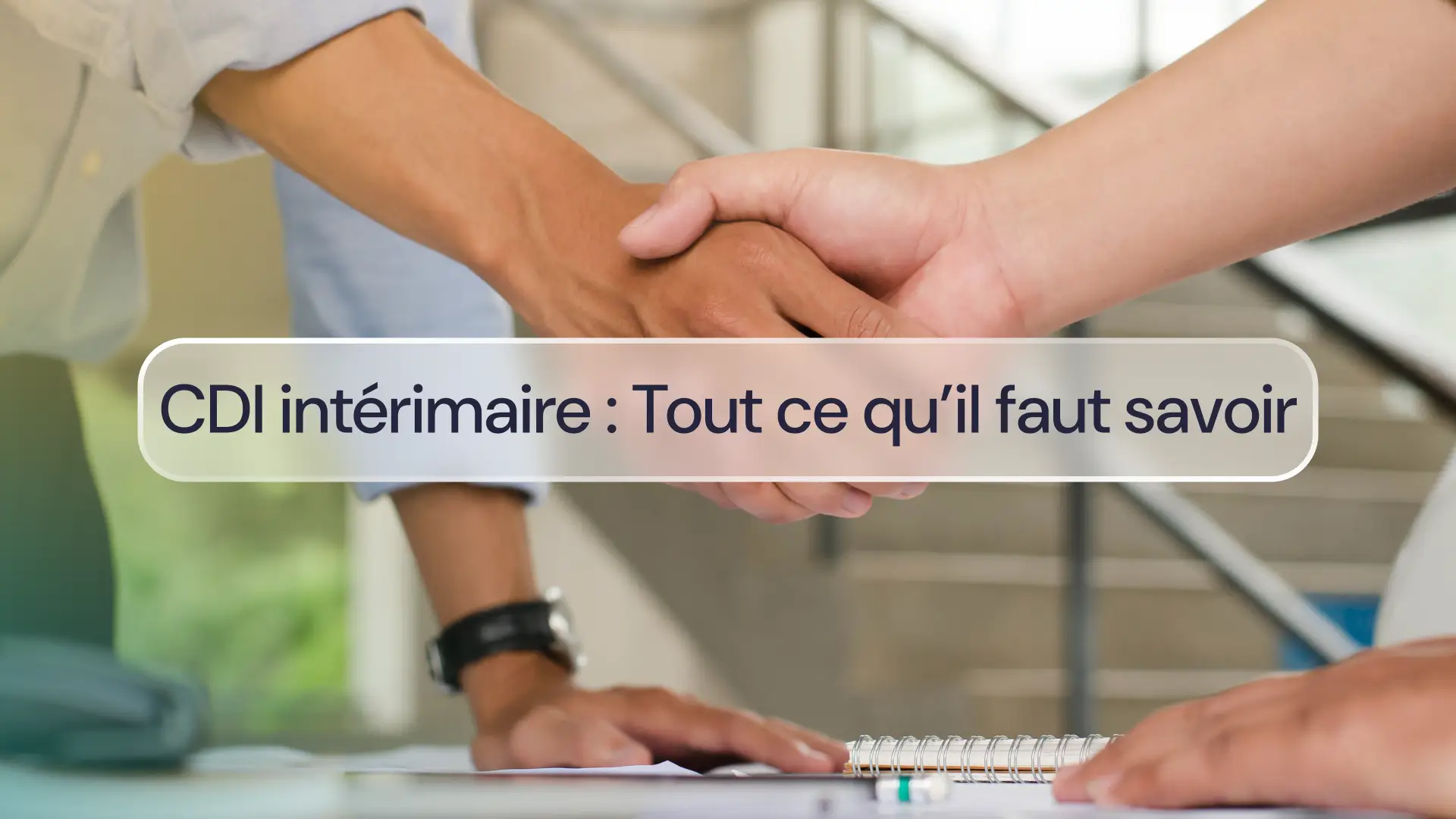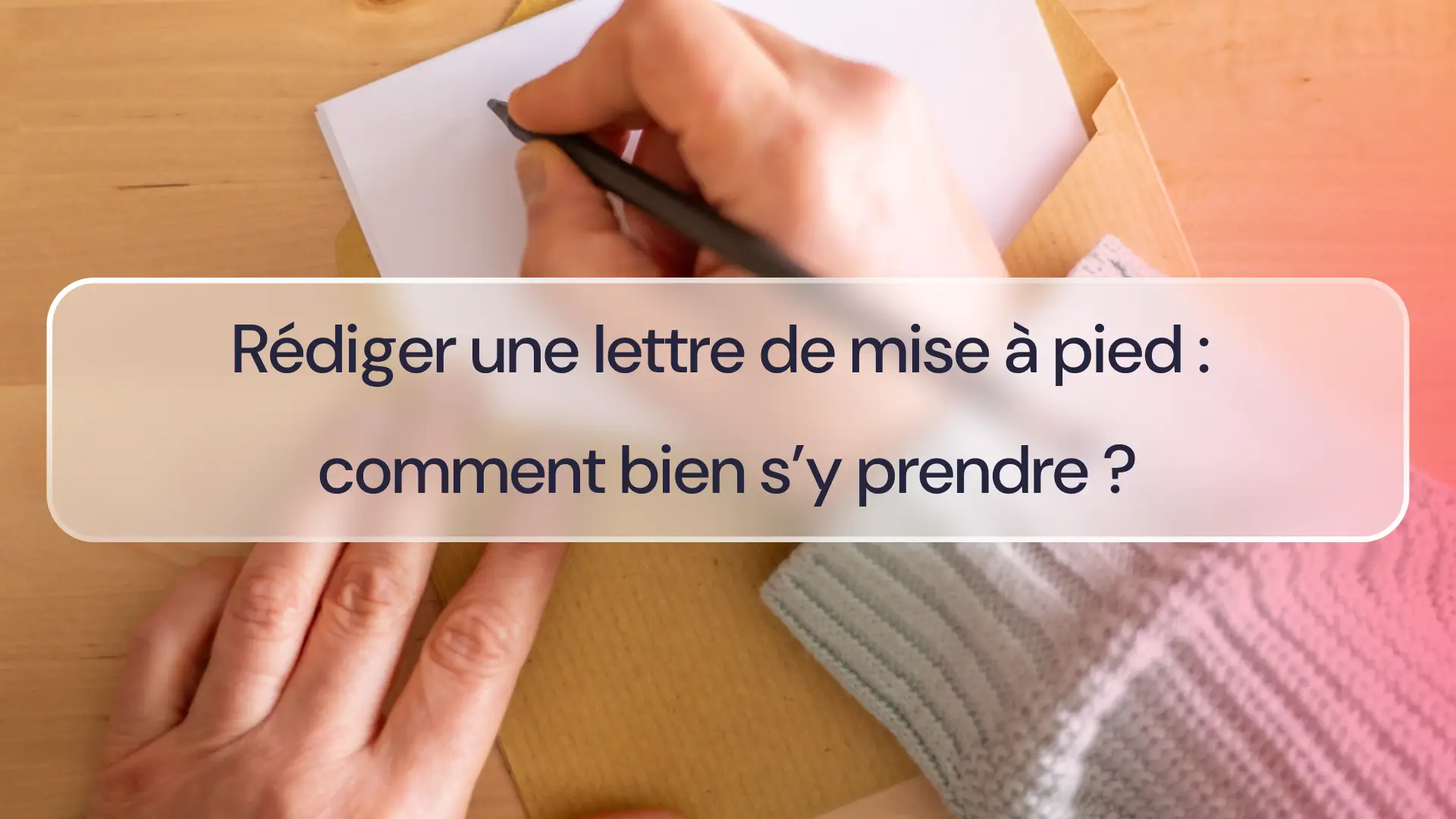Au deuxième trimestre 2025, selon la Dares, 130 300 ruptures conventionnelles ont été signées dans le privé, tandis que les licenciements pour motif personnel ont atteint 227 400 sur la même période. Deux dispositifs largement utilisés, souvent envisagés dans des situations très proches, mais aux logiques juridiques opposées.
Pour les entreprises, choisir entre rupture conventionnelle ou licenciement n’est jamais un simple choix administratif : ce choix influence l’indemnité, le calendrier, l’accès au chômage, la charge pour la paie et le risque contentieux.
Voici comment comparer clairement les deux modes de rupture afin de sécuriser vos décisions et adapter votre stratégie RH peu importe les situations rencontrées.
Rupture conventionnelle ou licenciement : les différences clés
Rupture conventionnelle : une rupture basée sur l’accord des parties
La rupture conventionnelle repose sur une volonté commune du (de la) salarié(e) et de l’employeur. Elle s’applique uniquement aux CDI et suit une procédure encadrée :
- entretien(s),
- signature du Cerfa,
- délai de rétractation
- puis homologation par la Dreets.
L’indemnité versée ne peut être inférieure à l’indemnité légale de licenciement. La date de fin du contrat est librement fixée, ce qui facilite la planification.
Licenciement : une rupture décidée par l’employeur et fondée sur un motif
Le licenciement est une décision unilatérale reposant sur un motif personnel réel et sérieux (discipline, insuffisance, inaptitude) ou sur un motif économique. La procédure comporte :
- une convocation,
- un entretien préalable
- et une notification motivée.
La justification du motif peut faire l’objet d’un recours prud’homal, ce qui impose une documentation précise.
Préavis, délais et congés payés : les différences selon le mode de rupture
La procédure de rupture conventionnelle implique :
- un délai de rétractation de 15 jours calendaires,
- un délai d’homologation de 15 jours ouvrables,
- une date de rupture fixée avant la fin de la période d’homologation.
Le licenciement implique :
- le respect d’un préavis légal ou conventionnel (sauf faute grave ou faute lourde),
- une rupture effective à la fin de ce préavis,
- un versement spécifique des congés payés non pris dans le solde de tout compte.
Dans les deux cas, les congés restants ouvrent droit à une indemnité compensatrice, mais selon des calendriers et des règles distincts.
Impact RH : organisation, paie et niveau de risque
Le choix entre rupture conventionnelle et licenciement influence la gestion interne de l’entreprise à travers :
- la planification du départ,
- la gestion des remplacements,
- le traitement de la dernière paie et la DSN,
- le climat social en fin de contrat,
- le risque de contentieux.
La rupture conventionnelle donne une visibilité plus stable pour les équipes RH. Le licenciement nécessite une documentation solide pour sécuriser le motif et anticiper un éventuel recours.
Comment mener une rupture conventionnelle ou un licenciement sans erreur ?
Rupture conventionnelle : ce que l’employeur doit cadrer dès le début
Une rupture conventionnelle démarre toujours par un échange clair avec le salarié(e). L’enjeu consiste à poser les bases :
- la date envisagée de fin du contrat,
- les conditions du départ,
- le solde des congés payés,
- le niveau d’indemnité.
Une fois le formulaire signé, les délais se déclenchent automatiquement. Le droit de rétractation, puis l’homologation imposent un calendrier serré qui ne laisse pas de place aux approximations. La Dreets vérifie alors le formulaire, les dates, l’indemnité proposée et la cohérence de l’ensemble.
L’employeur doit surtout anticiper ce qui peut bloquer l’homologation :
- un formulaire incomplet,
- une indemnité inférieure au minimum légal,
- une date de rupture placée trop tôt,
- une procédure mal documentée.
Quand ces points sont maîtrisés, la fin de contrat se déroule sans difficulté et les droits du(de la) salarié(e) peuvent être transmis à France Travail sans retard.
Licenciement : une procédure plus exigeante, surtout sur le motif
Le licenciement demande un travail préparatoire plus lourd. Avant même d’envoyer la convocation, il faut vérifier que le motif tient la route. Cela signifie des faits établis pour un dossier disciplinaire, des éléments objectifs pour une insuffisance professionnelle ou encore un avis du médecin du travail pour une inaptitude.
L’entretien préalable sert à présenter la situation au(à la) salarié(e) et à écouter sa version des faits. La lettre de licenciement doit ensuite reprendre le motif de manière précise. Une formulation vague ou une date incorrecte suffit à fragiliser toute la procédure.
Une fois ces étapes suivies, la rupture devient juridiquement opposable et la fin de contrat peut être transmise à la paie.
Coûts et impacts RH : ce que l’entreprise doit vraiment anticiper
Indemnités de départ : ce qui change selon le mode de rupture
Qu’il s’agisse de rupture conventionnelle ou de licenciement : l’indemnité est rarement la même, et les écarts peuvent être significatifs.
La rupture conventionnelle impose un plancher : l’indemnité spécifique ne peut être inférieure à l’indemnité légale de licenciement. Dans les faits, un complément est souvent négocié pour obtenir l’accord du salarié.
Côté licenciement, l’indemnité varie selon :
- le motif (hors faute grave/lourde),
- l’ancienneté
- et la convention collective.
En cas de licenciement, le coût final dépend surtout du préavis à indemniser et des règles conventionnelles applicables. Les montants peuvent varier fortement d’une branche à l’autre, ce qui nécessite une vérification systématique.
Dans les deux cas, ces sommes influencent ensuite le différé d’indemnisation chômage, un point souvent méconnu par les salariés et à expliquer dès le début de la discussion.
Coût global pour l’entreprise : au-delà de l’indemnité
L’indemnité n’est qu’une partie du vrai coût.
Une rupture conventionnelle peut sembler plus onéreuse sur le papier, mais elle sécurise le calendrier et limite presque à zéro le risque contentieux.
À l’inverse, un licenciement peut coûter moins cher immédiatement… tout en générant des coûts indirects :
- un préavis prolongé,
- des rappels de primes ou d’heures,
- des risques prud’homaux si le dossier est fragile,
- du temps mobilisé par les managers et la RH pour documenter chaque étape.
Dans un contexte où les prud’hommes contrôlent de plus en plus strictement les motifs, le coût du risque peut dépasser largement l’indemnité initiale.
Risques juridiques : ce que les RH doivent sécuriser
Les risques ne se situent pas au même endroit selon le mode de rupture :
- Lors d’une rupture conventionnelle, le point sensible reste l’homologation Dreets : une date incohérente, un formulaire incomplet ou une indemnité insuffisante peuvent entraîner un refus.
- Lors d’un licenciement, le risque est surtout judiciaire. Un motif vague, des faits mal établis, un entretien insuffisamment documenté ou une lettre imprécise augmentent la probabilité d’un recours. Les juges exigent désormais une justification précise, qu’il s’agisse d’insuffisance, d’inaptitude ou de discipline.
Impact organisationnel : continuité de l’activité et remplacements
Quelle que soit la modalité choisie, une rupture impacte immédiatement l’organisation. Certaines équipes absorbent la transition sans difficulté ; d’autres se retrouvent en surcharge dès le départ du collaborateur.
Pour les décideurs RH, l’enjeu est d’anticiper :
- la durée prévisible de vacance du poste,
- la redistribution des missions critiques,
- la charge supplémentaire pour les managers,
- le risque de désengagement au sein du collectif.
Là où la rupture conventionnelle permet souvent de planifier sereinement la transition, le licenciement crée parfois une rupture plus brutale, nécessitant des ajustements rapides pour maintenir l’activité.
Choisir le bon mode de rupture
Le bon choix n’est jamais uniquement juridique ou financier. Pour les décideurs RH, la décision doit combiner :
- l’état de la relation de travail,
- la solidité du dossier,
- le degré de remplaçabilité du poste,
- le niveau d’urgence,
- le risque contentieux réel,
- et l’impact sur l’activité.
Une rupture conventionnelle peut coûter plus cher mais stabiliser le climat social. Un licenciement peut sembler légitime mais fragiliser une équipe déjà à bout.
👍 Choisir entre une rupture conventionnelle ou bien un licenciement n’a rien de simple… Par contre, choisir le logiciel RH qui vous facilite vraiment votre gestion RH, c’est simple et à portée de clic ! Réservez votre démo offerte, un expert Factorial est là pour répondre à toutes vos questions.
Conclusion
Séparer les trajectoires professionnelles via une rupture conventionnelle ou un licenciement dépasse le simple geste technique. Pour les équipes RH, le bon choix dépend autant du dossier que du fonctionnement interne, du climat social et de la continuité de l’activité.
Néanmoins, l’enjeu est essentiel : choisir le mode de rupture qui sécurise l’entreprise aujourd’hui, tout en préservant sa capacité à avancer demain.
FAQ : Rupture conventionnelle ou licenciement
1. Rupture conventionnelle ou licenciement : quel est le plus avantageux pour l’employeur ?
Tout dépend de l’objectif :
- La rupture conventionnelle offre un départ maîtrisé, peu de risque contentieux et une date de fin choisie. C’est l’option la plus stable lorsqu’il existe encore un minimum de coopération avec le(la) salarié(e).
- Le licenciement est plus adapté lorsque la relation de travail est rompue ou que le maintien n’est plus possible, mais il demande un dossier solide et expose davantage l’entreprise en cas de contestation.
Pour un employeur, l’arbitrage se fait surtout entre prévisibilité, risque juridique et impact organisationnel.
2. Une rupture conventionnelle coûte-t-elle plus cher qu’un licenciement ?
Pas forcément, mais c’est fréquent. L’indemnité de rupture conventionnelle ne peut pas être inférieure à l’indemnité légale de licenciement, et de nombreuses entreprises ajoutent un complément pour obtenir l’accord du(de la) salarié(e).
Le licenciement peut sembler moins coûteux, mais le préavis, les rappels de salaire et un éventuel recours prud’homal peuvent rapidement dépasser le coût d’une rupture amiable.
Le mode de rupture de contrat le “moins cher” dépend donc :
- du niveau d’ancienneté,
- de la nécessité ou non d’un complément d’indemnité,
- et du risque contentieux.
3. Est-ce que le(la) salarié(e) perçoit les allocations chômage après une rupture conventionnelle ?
Oui. La rupture conventionnelle ouvre droit au chômage uniquement si elle est homologuée ; le licenciement ouvre droit hors faute lourde. Le seul point d’attention concerne le différé d’indemnisation : plus l’indemnité versée est élevée, plus le versement de l’allocation peut être décalé dans le temps.
Pour les RH, il peut être intéressant d’expliquer ce différé afin d’éviter les malentendus et les demandes irréalistes lors de la négociation.